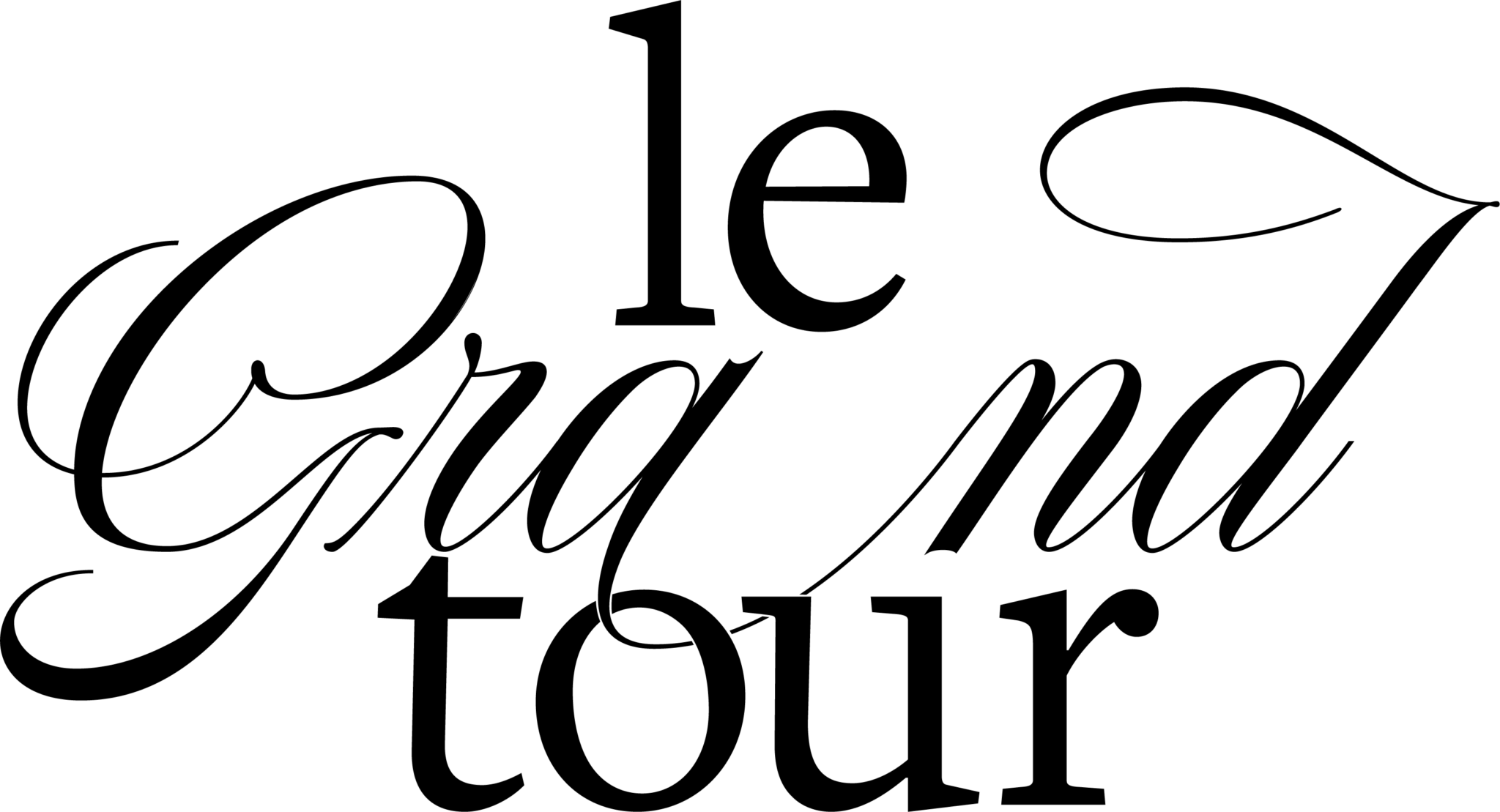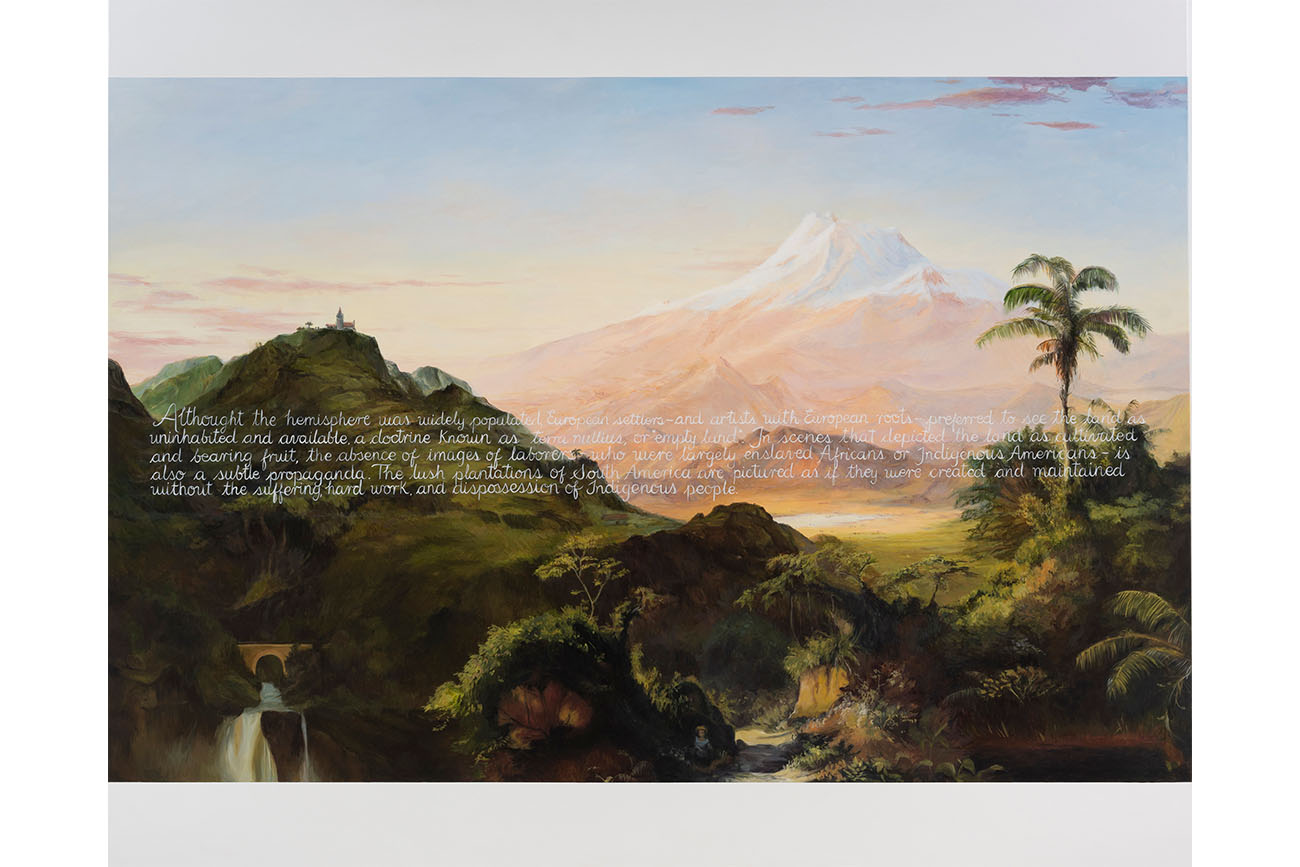Pinacoteca Migrante
Décoloniser le musée
Publié le 06/05/2024
Sous les apparences les plus classiques d’une galerie de peintures bien ordonnée, Sandra Gamarra défie les récits coloniaux et propose une perspective inversée à partir des collections muséales espagnoles.
Bienvenue dans le théâtre du musée décolonial.