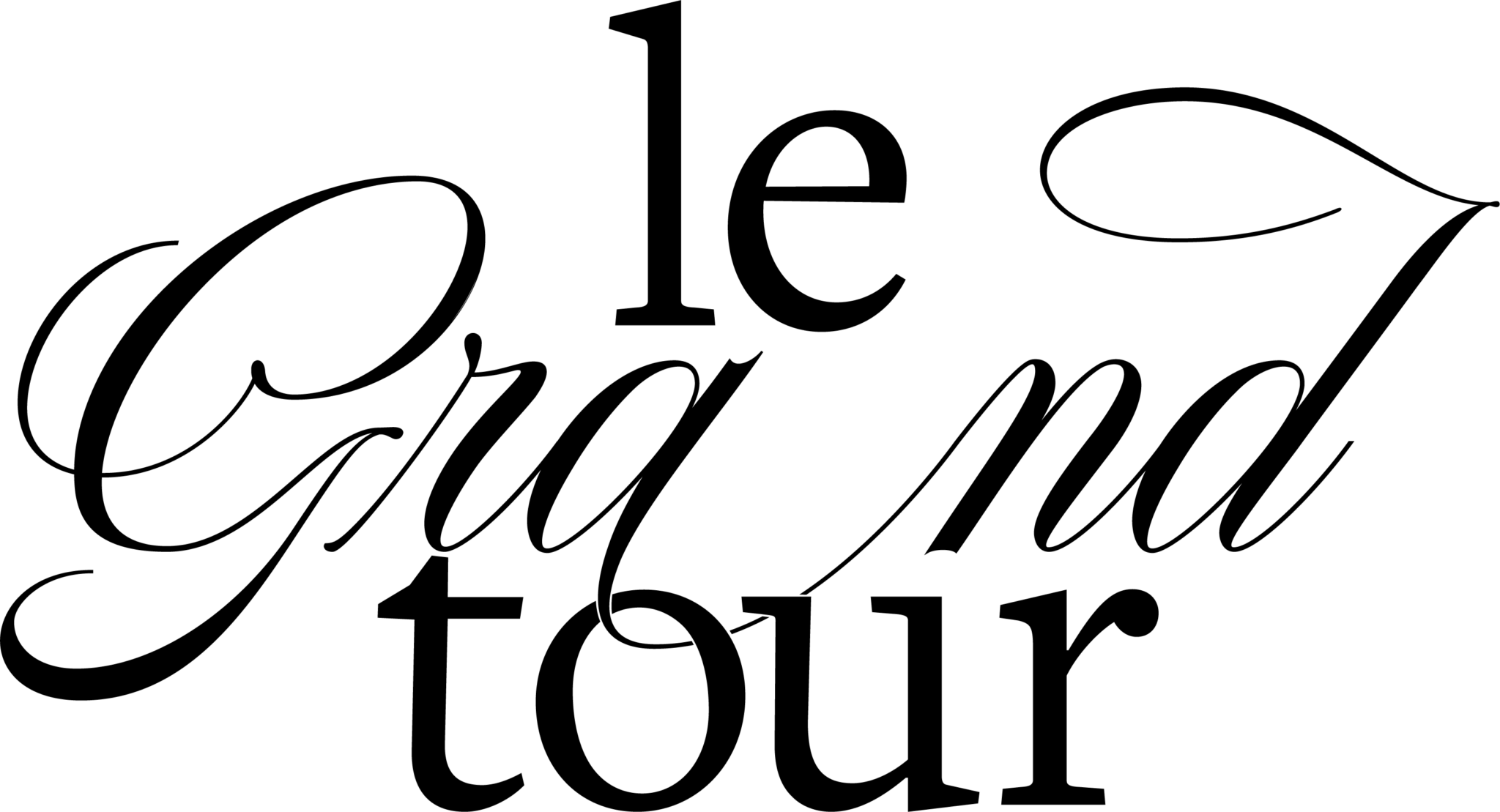Publié le 24/05/2024
Les Jeux Olympiques
de l’art contemporain

L’analogie de l’or n’est pas (seulement) un lieu commun en période olympique : c’est de toute évidence un constat. Les exercices artistiques réalisés à la Biennale ne requièrent pas moins de talent, d’endurance, de précision technique et de moyens financiers que ceux des athlètes de haut niveau, et le fait de l’avoir fait sera cité, non pas une fois, mais pour toujours, comme un insigne gravé sur un CV. Malgré son indéniable prestige, le badge suffit-il à lui seul à augmenter la cote globale d’un artiste ?
Visibilité et prestige
Comme le reconnaît Iván Argote (Bogota, 1983) dont l’œuvre fait partie de l’Exposition internationale curatée par Adriano Pedrosa, être sélectionné à la Biennale est en soi un honneur et une possibilité de laisser sa marque dans l’Histoire. « C’est une joie de participer à cette première Biennale dirigée par un commissaire latino-américain et qui travaille dans le Sud Global. Tous les deux ans, 300 artistes passent par Venise – et plus d’une centaine d’autres provenant des pavillons. En soixante éditions, cela fait 24 000 ! On est un de plus parmi ces 24 000… Et c’est beau de participer à cette conversation. »
Cette conversation – qui représente déjà un exploit pour ceux qui la composent – se déroule également sous les yeux de près d’un million de visiteurs. Sous le commissariat de Cecilia Alemani, la précédente édition, The Milk of Dreams, a accueilli 800 000 spectateurs, en plus des 22 500 qui l’ont visitée lors des previews.
Ces previews sont des événements capitaux au cours desquels le Who’s Who du monde de l’art, et notamment les conservateurs, les responsables de musées, les galeristes et les collectionneurs du monde entier découvrent des centaines d’œuvres inédites et ambitieuses réalisées par d’éminents artistes. Pour un galeriste expérimenté, il est fascinant de constater que « les jours de preview, la Biennale est un supermarché, avec des collectionneurs qui courent partout et négocient des achats sur place », d’une manière plus intense encore que lors du premier jour d’Art Basel par exemple. L’effet d’exclusivité et d’importance est soigneusement cultivé par les organisateurs de la Biennale, qui gardent les détails des œuvres présentées, limitant les interviews et autres fuites d’informations possibles avant l’ouverture.
Le suspense est palpable pendant ces premiers jours où « les gens stressent de ne pas avoir accès aux œuvres, d’autant plus que, contrairement à une foire, ici on ne peut rien communiquer à l’avance. » Mais cette euphorie ne se traduit pas nécessairement par une augmentation durable des ventes ou même de la valeur globale d’un artiste donné.
Directrice de la galerie Michel Rein, Alice Joubert-Nikolaev a vu plusieurs de ses artistes passer dans les pavillons nationaux de la Biennale de Venise. « Nous avons eu Dora García (2011) et Jordi Colomer (2017) dans le pavillon espagnol, Dan Perjovschi dans le pavillon roumain (1999), Stefan Nikolaev dans le pavillon bulgare (2007) et Mark Raidpere dans le pavillon estonien (2005). Et puis il y a tous les artistes qui ont participé au pavillon international, comme Dora García ou Jimmie Durham, qui a d’ailleurs reçu le Lion d’or pour sa carrière en 2019. » Avec le recul de sa grande expérience, Alice Joubert-Nikolaev constate que « pour les artistes qui participent, c’est une très belle ligne dans le CV. Avec un peu de chance, on peut vendre une ou plusieurs des œuvres présentées dans la Biennale, mais en règle générale, cela arrive toujours après. » Plus qu’un effet de marché, « le retour se fait surtout en termes d’image et de reconnaissance d’un milieu professionnel. »
La géopolitique mondiale en miniature
« Toute la géopolitique du monde actuel se reflète dans la Biennale de Venise » affirme la directrice de la galerie Poggi, Camille Bréchignac. Dans l’édition actuelle, quatre de ses artistes sont exposés : l’émergent Troy Makaza (1994, Harare) qui représente le Zimbabwe auprès d’autres artistes dans une exposition collective ; le vétéran Nikita Kadan (1982, Kiev), qui participe à l’événement collatéral de la Fondation Victor Pinchuk, Daring to Dream in a World of Constant Fear ; l’artiste en plein essor Josèfa Ntjam (1982, Metz), qui bénéficie d’une exposition personnelle à l’Accademia di Belle Arti di Venezia ; et l’artiste confirmée Kapwani Kiwanga (1978, Hamilton), sélectionnée pour le pavillon canadien.
Représenter ces artistes à la Biennale de Venise à différents moments de leur carrière donne au galeriste un large champ d’action, lequel exige des stratégies spécifiques et des résultats très différents pour chacun d’entre eux. Même si Kapwani Kiwanga est l’artiste la plus reconnue parmi les quatre, la galeriste relativise l’effet que la Biennale pourrait avoir sur sa carrière. « Pour Kapwani, c’est bien sûr un événement important, mais il y en a tellement d’autres qui ont lieu en ce moment, comme ses expositions personnelles au CAPC de Bordeaux (Retenue, 2023-2024), au Kunstmuseum Wolfsburg (2023), ainsi qu’au Copenhagen Contemporary (The Lenght of the Horizon, 2024). Sans compter le projet pour la Highline à New York (2023-2024). La Biennale s’ajoute à une liste importante de reconnaissances dont elle bénéficie déjà en ce moment. » L’artiste elle-même avait déjà participé à l’exposition de Cecilia Alemani lors de la précédente édition, au cours de laquelle « toutes ses pièces se sont vendues immédiatement, mais en même temps, on ne peut pas dire qu’il y ait eu un emballement débridé pour son travail, il s’agissait plutôt de la poursuite d’une dynamique déjà préexistante. »
Selon Camille Bréchignac, Josèfa Ntjam, qui a récemment présenté l’ambitieuse exposition Matter, Gone, Wild à la Fondation Pernod Ricard à Paris, est « l’artiste pour laquelle la Biennale a le potentiel d’être l’expérience la plus transformatrice, parce qu’elle a une carrière qui, bien qu’émergente, a déjà un suivi institutionnel significatif. » Celui-ci se traduit par des opportunités de montrer son travail dans des forums internationaux, dont certains sont déjà « impatients de programmer le travail qu’elle produit pour la Biennale », attirant l’attention des comités d’acquisition exclusifs des grandes collections institutionnelles à travers le monde. En ce sens, la participation de l’artiste à la Biennale de Venise « est le signe supplémentaire qu’elle fait partie des jeunes artistes que le monde entier doit suivre. » La galeriste voit dans la Biennale « un accélérateur de particules qui accroît la dynamique déjà en place pour les artistes. »
À l’opposé de ces artistes issus des diasporas africaines, qui ont pu compter sur le soutien institutionnel ou gouvernemental des pays occidentaux, l’artiste zimbabwéen Troy Mazaka expose à l’extérieur des Giardini qui abritent les pavillons des nations principalement issues du Nord, dans une sorte de portrait architectural des puissants États-nations du 20e siècle. « Être dans le pavillon du Zimbabwe n’a pas le même poids politique qu’un pavillon fait sur mesure par une fondation allemande avec un budget colossal », souligne Camille Bréchignac. Cependant, cette édition centrée sur les pratiques diasporiques, délocalisées, entre deux lieux et issues des marges à partir desquelles les artistes migrants, exilés ou réfugiés ont historiquement dû travailler, est une occasion unique pour ces pratiques d’occuper de facto le devant de la scène, au-delà des cadres rigides des Giardini que Mark Lackey a décrits comme « un parcours de golf miniature où chaque trou a un thème » (Pavillon britannique, 55e Biennale).
Une question sans réponse
Dans une étude réalisée en 2022 pour la revue universitaire australienne Poetics, cinq chercheuses de différentes disciplines se sont penchées sur la question suivante : peut-on vraiment parler d’un « effet Venise » ?
Les chercheuses ont décortiqué les CV de 98 artistes originaires de six pays ayant participé à la Biennale de Venise entre 1997 et 2017, en prenant en compte leur genre, leur niveau de carrière (émergent, à mi-carrière ou établi) et leur territoire d’appartenance. Leur recherche repose sur le postulat que la multiplication des occasions d’expositions augmente la réputation et donc favorise la carrière de l’artiste.
Si l’un des effets positifs quantifiables de la présence des artistes à la Biennale de Venise est leur visibilité accrue dans les expositions, l’étude ne permet pas de conclure d’effet positif sur les cinq années suivant leur participation. Au contraire, elle observe même un recul de celles-ci.
Une exception intéressante concerne les artistes émergents issus de ce que l’on appelle les « périphéries de l’art ». Pour ces derniers, les expositions internationales ont augmenté de 20 %. C’est en particulier le cas des artistes sud-coréens, dont la participation aux expositions internationales demeurait faible avant la Biennale – un constat qui souligne l’opportunité exceptionnelle que représente cet événement pour les artistes sélectionnés.
Cette année, le commissariat d’Adriano Pedrosa remet en question les catégories binaires qui sont utilisées à ce jour pour définir qui a le droit de faire partie de l’Histoire. Interroger ces étiquettes imposées par les dynamiques coloniales (centre/périphérie, Nord/Sud) est fondamentale dans les deux chapitres de Pedrosa, l’un contemporain et l’autre historique. Parmi les artistes exposés, nombreux sont ceux qui ne sont pas représentés en galerie, et qui exposent pour la première fois à la Biennale de Venise.
Si pour les artistes des centres d’art occidentaux, l’« effet Venise » n’est pas immédiatement perceptible, quel sera l’effet de la Biennale sur la carrière de tous ceux qui, non seulement viennent géographiquement des périphéries supposés, mais aussi qui, dans leurs approches, relèvent de pratiques considérées comme marginales (queer, populaires, artisanales) ? C’est une réponse que seul le temps permettra d’élucider.
Par-delà l’immédiateté
Dans un monde de l’art où la Biennale de Venise apparaît comme le théâtre d’une éternelle résurgence culturelle, il est essentiel de reconnaître la dynamique de transformation qu’elle impose. Telle une arène olympique pour quelques privilégiés, la Biennale élève la trajectoire des artistes, contribuant à tisser leur empreinte sur le tapis d’une histoire en cours de réécriture. Pour ces créateurs, qu’ils soient issus des centres ou des périphéries supposées, l’effet de la Biennale ne se mesure pas tant à l’immédiateté des acclamations qu’à l’intégration durable dans les canons artistiques mondiaux : un écho continu, entre l’innovation du moment et l’héritage intemporel de l’art. Selon Iván Argote, le véritable effet « est incommensurable et incalculable. Le mieux est de profiter de cette plateforme pour dire quelque chose, en essayant de le faire avec honnêteté et force, et de profiter pleinement de ce moment. »