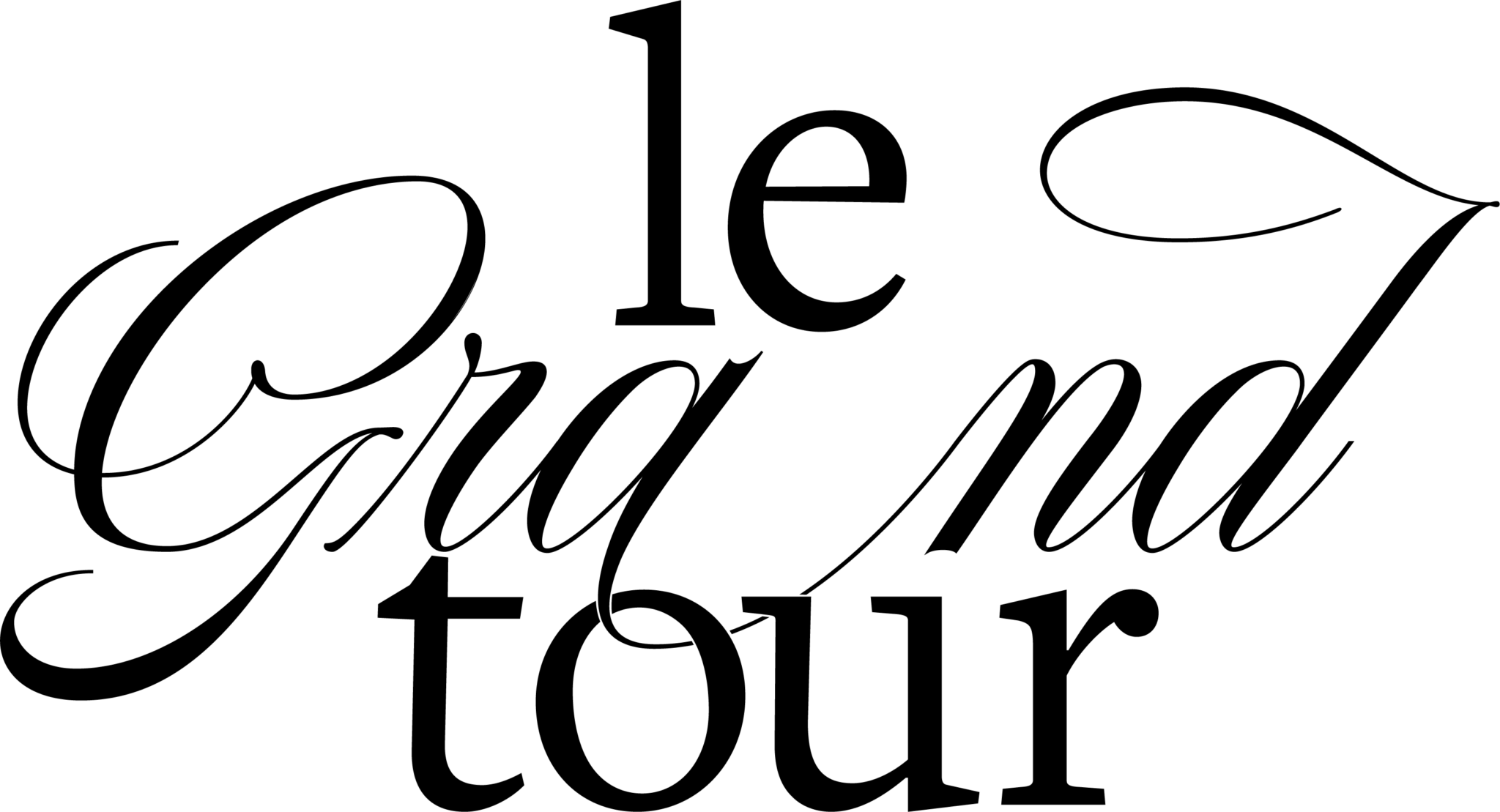C’est chez elle, à Tahannaout, que nous avons rencontré Fatiha Zemmouri. Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, l’artiste marocaine a quitté le tumulte de la ville pour rejoindre la campagne de Marrakech, où elle vit depuis près de dix ans. « J’avais besoin de voir la terre, de la sentir, de la toucher. » Ici, la terre brune s’étend, imprenable, sur les plateaux du Haut-Atlas. Dans sa maison qui est aussi son atelier, Fatiha Zemmouri cultive des parcelles de terre et vit au gré des saisons. « Depuis que j’habite ici, mon rapport au temps a changé. Je contemple la terre. À la mi-saison, elle s’ouvre, humide. Puis elle germe, lorsque les conditions climatiques sont réunies. Mais à l’été, la terre se dessèche et craquelle. C’est un territoire extrême duquel je me sens très proche. »
Cette terre de Tahannaout, Fatiha Zemmouri en a fait son médium. Les teintes ocre, caractéristiques de la région, se retrouvent aux murs, dans des compositions monochromes qui rappellent certains éléments de la peinture abstraite. « À travers mon travail, je souhaite donner à voir autrement ce sol que l’on foule mais que l’on ne regarde jamais. » La matérialité de ses œuvres est saisissante. La dimension sculpturale que confère l’épaisseur de certaines pièces est contrebalancée par leur fragilité apparente, fissurées de toutes parts. D’autres, plus fines, sont faites de sillons que l’artiste a tracés à même la matière. Ces formes font écho à celles des jardins japonais, ou peut-être à la marque du passage de l’homme dans les champs. Mais Fatiha Zemmouri ne cherche pas à déchiffrer ce vocabulaire abstrait. « C’est avant tout un geste instinctif, puis intuitif. » Un geste qu’elle compare toutefois aux tatouages au henné, lorsque le dessin d’une forme en entraîne une autre. Elle mentionne aussi l’influence des motifs géométriques de l’art islamique, dont son imaginaire est imprégné.
Les œuvres de l’artiste marrakchie surprennent par leur verticalité. Comment parvient-elle à immobiliser cette terre extrêmement friable ? Dans son atelier, Fatiha Zemmouri évoque de longues heures d’expérimentation, au cours desquelles elle rend la terre infertile, à l’aide d’un liant hydrofuge, qu’elle solidifie ensuite avec de la fibre de verre. « Je rêve d’abord les pièces, et toute l’excitation est dans le chemin me permettant d’y arriver. » Pour la Biennale de Venise, c’est une œuvre architecturale dont elle a rêvé.
Un mois après le séisme qui a frappé le Maroc, Fatiha Zemmouri entame son travail. Dès l’origine, elle sait que son œuvre sera habitée par cet événement. Au sein d’une vaste structure, des panneaux sont scindés en plusieurs fragments, puis recouverts de terre. L’artiste travaille ensuite longuement chaque partie, espérant recréer à l’aveugle les sillons qu’elle avait imaginés. Inéluctablement, les fractures de l’œuvre évoquent les destructions causées par le cataclysme. Elles sont ces blessures qui ont forcé les personnes à quitter leur terre natale, devenue inhabitable. « Par sa dimension architecturale, cette œuvre est non seulement le symbole de la terre que l’on quitte, mais aussi de ces murs qui ne nous protègent plus, parce qu’ils ont été démolis. C’est un travail qui explore le fait d’être étranger chez soi, dans son propre pays. » Mais cette œuvre n’offre pas une image du désastre. Dans cette structure, l’artiste est parvenue à maîtriser chacune des craquelures pour rendre à la terre toute sa force. Vigoureuse et vibrante, c’est une terre résiliente que Fatiha Zemmouri dresse dans cette œuvre.