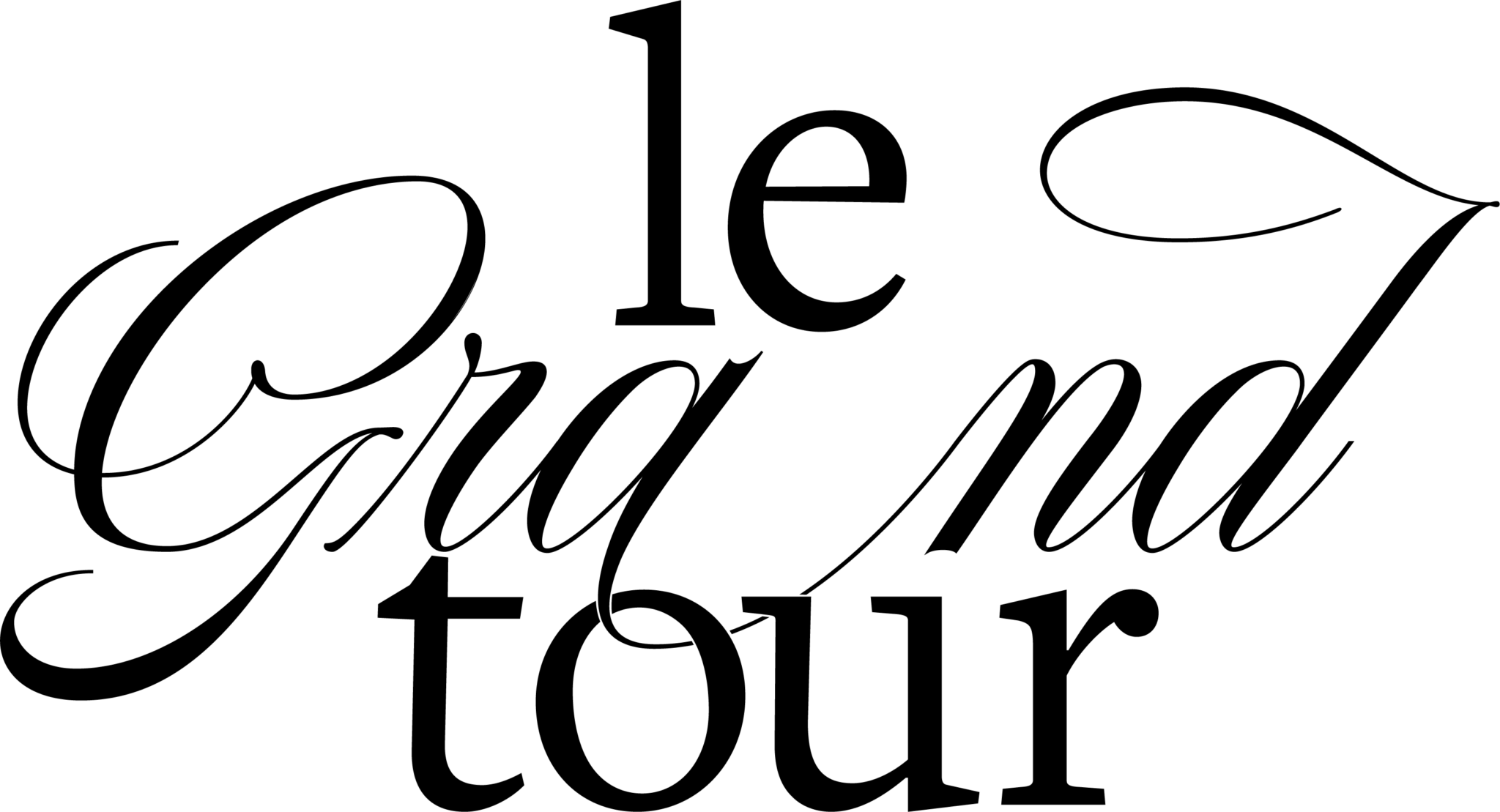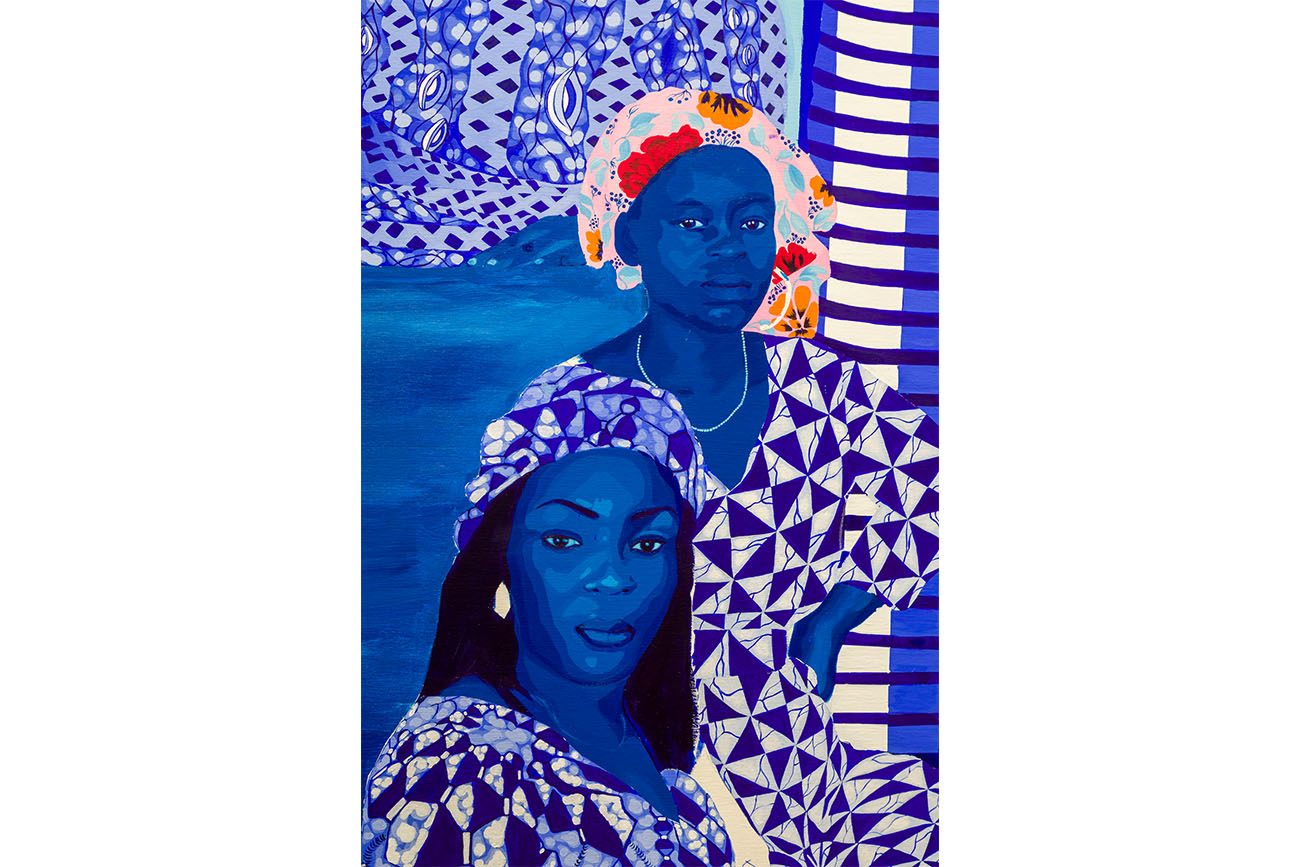D’où viennent les objets ? Quelles sont leurs origines, leurs trajectoires, leurs significations ? Quelles lectures offrent-ils du monde ? Tels sont les questionnements qui animent la pensée de Chloé Quenum. Depuis plusieurs années, l’artiste franco-béninoise explore la complexité des objets, qu’elle ne regarde jamais comme des artefacts, figés dans le passé, mais toujours comme les témoins d’une mémoire vivante. Par des jeux de déplacement et de transposition, Chloé Quenum questionne la perception que l’on a des objets dans un contexte donné.
Alors qu’elle parcourt la collection de la Tour Musique au musée du Quai Branly – cet écrin de verre conçu par Jean Nouvel – l’artiste découvre des instruments issus du Royaume du Danhomè, situé dans l’actuel Bénin. Cloche, xylophone, tambour, trompette, flûte… retiennent peu à peu son attention. « Ce sont des instruments humbles, rudimentaires. Par leur fonction, ils ont une dimension universelle. Ils ne sont pas décoratifs, et l’on a parfois même du mal à les identifier. » Cette indétermination passionne Chloé Quenum, qui cherche dans les objets d’autres niveaux de lecture.
Dans cet orchestre silencieux, elle interroge le rôle joué jadis par ces objets, avant que ceux-ci ne rejoignent les vitrines du musée. Telle une anthropologue, elle croise alors les sources pour tenter de retracer l’histoire de leur création et de leurs déplacements. Au détour de ses recherches, elle apprend que l’un d’entre eux, commandé par un colon aux artisans d’Abomey, simple élément décoratif, n’a jamais servi à jouer de la musique.
Fascinée par la complexité sous-jacente de ces instruments, l’artiste s’en inspire pour la Biennale de Venise. Comme toujours dans sa pratique, il n’est jamais question de reproduire les formes, mais plutôt d’en proposer une interprétation. Pour ce faire, elle fait le choix d’un seul matériau – le verre – qui guidera tout son processus créatif. Revenant sur les origines mésopotamiennes du verre et son usage comme monnaie d’échange pendant la traite négrière, Chloé Quenum voit aussi dans ce projet l’occasion d’explorer les potentialités de différentes techniques. Interrogeant notre perception, l’artiste conçoit à Nantes des objets en verre dont la silhouette évoque subtilement les instruments du Danhomè.
Au sein du pavillon béninois, les sculptures sont suspendues dans l’air, flottantes, telle une symphonie fantomatique qui ne sera jamais jouée. Mais une certaine musicalité se dégage de l’ensemble ; les sonorités sont suggérées par la matérialité même des objets, les aspérités du verre évoquant les vibrations produites par les instruments.
Accompagnant cette mélopée aphone, une large baie vitrée reprend l’architecture de l’Arsenal, ancien chantier naval dont l’histoire est étroitement liée à celle du commerce triangulaire. Sur une structure métallique, l’artiste reconstitue les carreaux de la fenêtre à l’aide du verre cordelé. Aussi appelé « verre colonial » – une dénomination conservée chez les verriers de la manufacture Saint-Just – ce verre artisanal, reconnaissable par ses irrégularités, est soufflé à la bouche depuis le 10e siècle. « Ce n’est pas un verre neutre », précise Chloé Quenum, « il déforme l’espace à travers lequel on le voit : c’est un verre qui offre un point de vue sur le monde. »
Dans cet ensemble fragile et précieux, Chloé Quenum suggère de faire un pas de côté. Elle propose une autre vision du monde, qui, loin de toute transparence, révèle la complexité des objets et leurs mouvements.