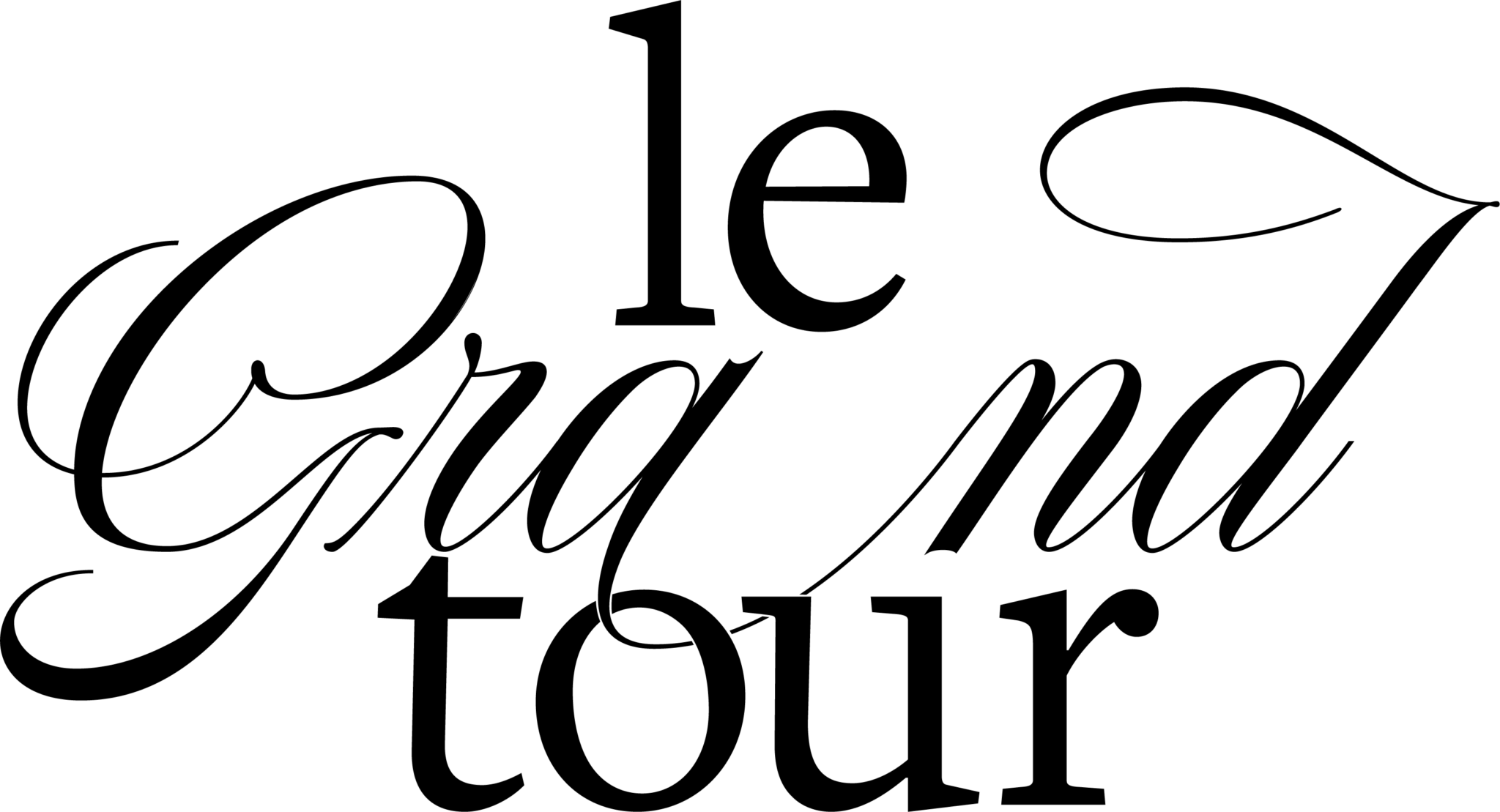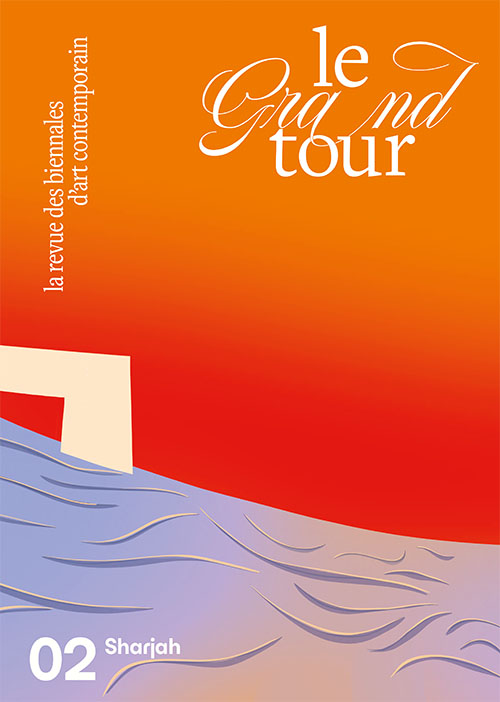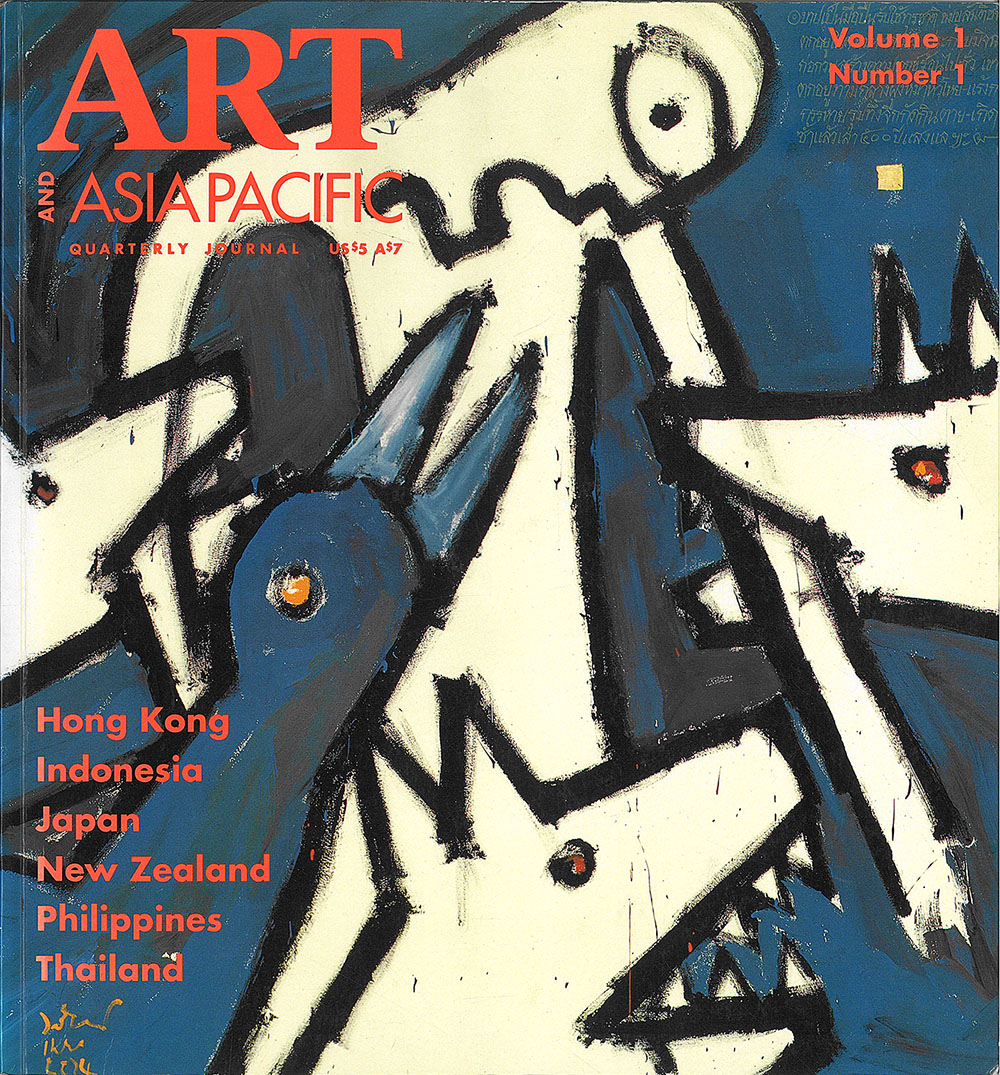Les années 1990 marquent également un tournant du côté des revues occidentales – du moins celles nées en Occident. Avant les années 1990, certaines publications universitaires avaient déjà décentré leurs perspectives sur des zones géographiques négligées par l’histoire de l’art. Ainsi, en 1967, le trimestriel African Arts voyait le jour à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Revue scientifique bilingue français-anglais sans parti pris idéologique particulier (si ce n’est celui de s’intéresser à des régions géographiques peu ou mal connues des intellectuels occidentaux), African Arts marquait déjà les prémices d’une critique d’art mondialisée.
Mais c’est véritablement à la fin du 20e siècle que l’on observe un tournant. Alors que la Guerre froide prend fin en 1989, le politologue américain Francis Fukuyama parle ironiquement d’une « fin de l’Histoire ». Selon lui, la dialectique historique est arrivée à son terme : face à la chute du communisme, l’hégémonie incontestée de l’ultra-libéralisme américain marque la fin du débat et des idéologies. Avec le recul, nous constatons à quel point Fukuyama s’est trompé. Pourtant, ses idées restent une clé de lecture précieuse pour comprendre dans quel contexte s’inscrit (ou plutôt se dés-inscrit) la production d’écrits sur l’art dans les années 1990.
En 1994, Nka: Journal of Contemporary African Art, est fondée à New York à l’initiative du critique, poète et commissaire d’exposition d’origine nigériane Okwui Enwezor
(1963 – 2019), installé aux États-Unis depuis 1982. Le titre de cette revue, Nka, est un mot de langue igbo qui peut signifier à la fois « art », « créativité » et « expression artistique ». Au sein de l’Africana Studies & Research Center de l’Université de Cornell, Okwui Enwezor s’entoure de deux autres intellectuels : Olu Oguibe, artiste, et Salah Hassan, historien de l’art, qui dirigent la revue à ses côtés. Leur objectif est clair : promouvoir le travail d’une nouvelle génération d’artistes d’origine africaine qui vivent sur le continent ou dans ses diasporas. Au fil des numéros, Nka participe à redonner aux avant-gardes artistiques africaines leurs lettres de noblesse, longtemps négligées par une histoire de l’art américaine opposant la « modernité » (l’Occident) à la « tradition » ou l’« authenticité » (l’Afrique). Il faut bien comprendre dans quelle ligne éditoriale s’inscrit cette publication : à rebours des représentations exotisantes, voire néocoloniales, qui persistent dans des expositions comme celle, historique, des Magiciens de la Terre (Paris, Centre Pompidou, 1989), Nka se place à contre-courant, faisant le choix d’une critique d’art panafricaine et ouvertement postcoloniale.
D’autres revues poursuivent des ambitions similaires outre-Atlantique. À Londres, l’artiste d’origine pakistanaise Rasheed Araeen fonde Third Text, Third World Perspectives in Art and Culture, en 1987 – peut-être l’une des plateformes de débats les plus importantes en Europe à la fin du 20e siècle. La revue naît dans une période d’agitation politique en Angleterre. Dans les années 1970, les militants du National Front, parti d’extrême-droite anglais, menacent régulièrement les habitants des quartiers populaires issus de l’immigration. Dans ce contexte, Araeen se radicalise, rejoignant le mouvement des Black Panthers anglais. Son œuvre, de plus en plus conceptuelle et politique, le pousse à délaisser la création plastique pour se consacrer à la critique et à l’édition. Comme le sous-entend son titre, Third Text est créée dans l’idée de produire du savoir sur l’art et les artistes dits du « Tiers-Monde », qui correspondrait à ce que l’on appelle aujourd’hui le « Sud global ». L’éditorial du premier numéro, rédigé par Araeen lui-même, souligne la mission de la revue en tant que plateforme critique : remettre en question les discours dominants sur l’art et la culture, en déplaçant un regard eurocentrique vers des perspectives plus inclusives. Third Text accomplit largement sa mission, publiant des études pionnières sur l’art et les artistes peu connus du public anglais, en dépit du fait que beaucoup, comme Araeen, sont actifs au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. Tout comme Nka, Third Text est très critique vis-à-vis des institutions. Dans son sixième numéro, la revue dénonce la curation exotisante des Magiciens de la terre, qui mystifie les productions des artistes dits « extra-occidentaux » et réactive de vieilles dichotomies qui opposent l’Europe au reste du monde ; la tradition à la modernité.